Alors que fait rage le débat public sur l’élaboration du budget 2026, Tripalio propose à ses lecteurs de prendre du recul sur ce thème avec une série pré-estivale sur l’évolution, sur le long terme, des modalités et du niveau du financement des principaux régimes collectifs et obligatoires de protection sociale français.

Après un retour sur la croissance sensible des taux de cotisation de protection sociale qui a lieu au cours des Trente Glorieuses – notamment due au financement des institutions paritaires – nous revenons ce jour sur l’émergence, au cours des décennie 1980 et 1990, de voies étatiques et paritaires en partie divergentes pour le financement de la protection sociale.
Des dynamiques de taux diversement haussières
Du point de vue le plus général, la dynamique des taux de prélèvements obligatoires de protection sociale des années 1980 et 1990 s’inscrit dans la poursuite de la trajectoire de hausse des taux de cotisation constatée au cours des Trente Glorieuses – comme résultat de la structuration progressive des régimes de protection sociale. Ainsi, entre 1981 et 1999, le taux de chargement total du salaire plafonné passe d’une combinaison entre des cotisations de 32,45 % du salaire plafonné, de 4,4 % du salaire jusqu’à trois plafonds, de 3,85 % du salaire jusqu’à quatre plafonds, de 8,3 % du salaire entre un et quatre plafonds de Sécurité sociale et, enfin, de 10 % sur la totalité du salaire au-delà du plafond à une combinaison entre des cotisations et prélèvements de près de 23 % du salaire plafonné, de 7,5 % du salaire jusqu’à trois plafonds, de 6,88 % du salaire jusqu’à quatre plafonds, de 20 % du salaire entre un et huit plafonds de Sécurité sociale, de 1,7 % au-delà du plafond, et, enfin et surtout, de 26,95 % sur le salaire.
Dans le détail, on constate que si ces hausses concernent à la fois le périmètre de la Sécurité sociale et celui des institutions paritaires de protection sociale, elles sont néanmoins plus ou moins importantes selon le cas considéré. En effet, à la Sécurité sociale, la forte hausse des prélèvements déplafonnés est à mettre en perspective avec la baisse notable du taux des cotisations sur la partie plafonné du salaire – il est divisé par deux sur le champ de la Sécurité sociale. En outre, à partir de 1993, les pouvoirs publics concèdent régulièrement, au motif de la défense de la compétitivité de l’économie française, des mesures d’allègements des cotisations sociales, pour des niveaux salaires pas toujours bas. Dans le cas des institutions paritaires de protection sociale, le mouvement de forte hausse des taux de cotisation : 70 % dans le cas du barème ARRCO, 140 % plus un élargissement de l’assiette à l’AGIRC ou encore 80 % pour le taux de cotisation chômage – est univoque. Comme durant la période précédente, c’est donc surtout le financement de la protection sociale paritaire qui contribue à la hausse des taux de cotisation.
Des sources de financement qui divergent
Outre ce mouvement, un second processus, tout aussi structurant, est initié durant la décennie 1990. Alors que, jusqu’à ce moment, le financement des dépenses de protection sociale est assuré par des cotisations, à partir de cette décennie, cette configuration évolue en partie. En effet, la création de deux prélèvements relevant de la fiscalité et assis, entre autres et pour ce qui concerne les actifs, sur la quasi-totalité de leurs revenus : la contribution sociale généralisée (CSG), dont le taux passe de 1 % en 1991 à 7,5 % à la fin de la décennie 1990, puis celle, en 1996, de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), d’un taux de 0,5 %, vient accompagner la baisse sensible des cotisations aux allocations familiales puis des cotisations à l’assurance maladie. Les gouvernements ainsi que les technocrates du social qui se succèdent à partir de la fin de la décennie 1980 justifient cette fiscalisation des ressources sociales en invoquant le fait que le bénéfice des prestations qu’elle contribue à financer ne doit plus être considéré comme dépendant de la participation au marché du travail mais comme universel.
Si, dans l’absolu, un tel argument aurait pu justifier le basculement, au moins partiel, d’une partie du financement de l’assurance chômage sur des prélèvements obligatoires de type fiscal, il n’en a rien été dans les faits. Au cours des années 1980 et, surtout, 1990, le principe du financement des institutions paritaires de protection sociale par des cotisations sociales n’a guère été remis en cause. En réalité, les fortes hausses du niveau de ces cotisations décidées par les partenaires sociaux ont même bien plutôt renforcer le lien entre protection sociale paritaire et cotisations sociales. Ce processus, qui probablement résulté en grande partie de la volonté des partenaires sociaux de conserver le contrôle de ce pan de l’action paritaire, n’est ni anodin ni tout à fait intuitif, puisqu’il signifie de fait que ce sont notamment des représentants du patronat français qui ont consolidé le recours au chargement du travail comme solution de financement de sa protection sociale.





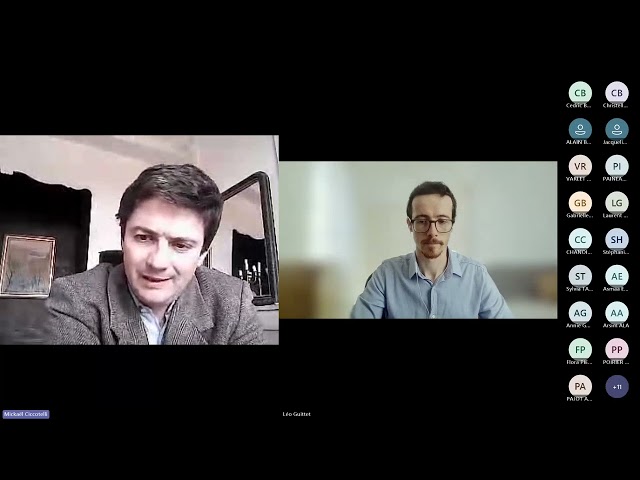
1 comment