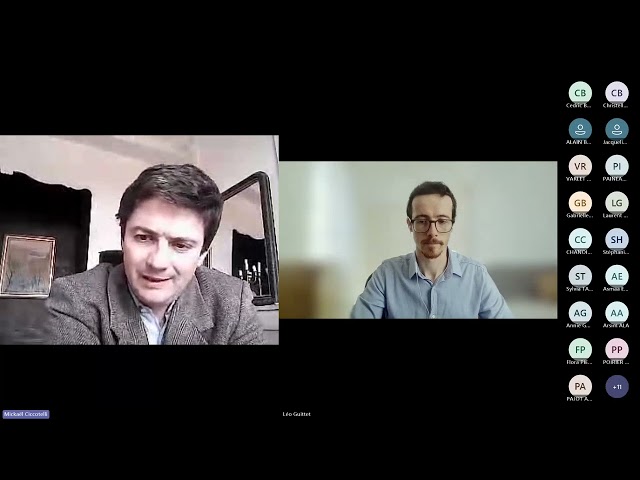Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat de salariés CFDT.
En application du principe de séparation des pouvoirs, l’appréciation de la validité d’une rupture conventionnelle d’un salarié protégé ne peut relever que du juge administratif. Le juge judiciaire ne peut pas statuer sur une rupture qui a été autorisée par l’inspection du travail, peu importe que le salarié évoque le vice de son consentement en raison d’un harcèlement moral. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt publié. Cass.soc.20.12.17, n°16-14880.
Selon l’article L.1237-14 du Code du travail, les litiges qui concernent la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes (et donc du juge judiciaire), à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. A côté de ça, l’article L.1237-15 du Code du travail prévoit que la rupture conventionnelle d’un salarié protégé, pour être valide, doit être soumise à une autorisation de l’inspecteur du travail, autorisation qui sera donnée après avoir vérifié la liberté du consentement des parties et l’absence de lien entre la rupture et le mandat et contrôlé la régularité de la procédure suivie.
- Faits, procédure
En l’espèce, un salarié protégé (un délégué du personnel) signe une rupture conventionnelle de son contrat de travail. L’inspection du travail autorise cette rupture. Pour lui, les consentements relatifs à cette convention étaient libres.
Quasiment 1 an après l’homologation de la convention, le salarié avance que son consentement donné à l’époque avait en réalité été vicié en raison du harcèlement moral dont il était victime. Il saisit le conseil de prud’hommes pour demander des dommages et intérêts et la nullité de la rupture conventionnelle.
Les juges du fond reconnaissent le harcèlement moral et octroient des dommages intérêts au salarié. En revanche, concernant la nullité de la rupture conventionnelle, les juges se déclarent incompétents au motif que la rupture conventionnelle concerne un salarié protégé et a donc été autorisée par l’inspection du travail. C’est donc au juge administratif de juger de la validité du consentement, peu importe qu’il s’agisse de harcèlement dont la reconnaissance et l’indemnisation relèvent de la compétence du juge judiciaire. Ils justifient leur raisonnement par le principe de séparation des pouvoirs.
Les juges de la cour d’appel renvoient donc le salarié « à mieux se pourvoir » en ce qui concerne sa demande de nullité de la rupture conventionnelle. Le salarié protégé aurait dû, selon eux, faire un recours gracieux ou hiérarchique et/ou faire un recours contentieux devant le tribunal administratif (1).
Le salarié décide de se pourvoir en cassation. Selon lui, le juge judiciaire reste compétent pour apprécier si cette rupture a pour origine un harcèlement moral exercé par l’employeur, qui conduirait alors à la nullité de la rupture conventionnelle.
La question posée à la Cour de cassation est la suivante : en cas de consentement vicié pour harcèlement moral, la validité de la rupture conventionnelle, autorisée par l’inspection du travail, relève-t-elle de la compétence du juge judiciaire ou du juge administratif ?
- Le juge administratif seul compétent, y compris en cas de harcèlement
Pour la Cour de cassation, « le juge judiciaire ne peut, en l’état de l’autorisation administrative accordée à l’employeur et au salarié bénéficiant d’une protection (…) pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d’un harcèlement moral ».
Autrement dit, dès lors que la rupture conventionnelle a été autorisée par l’inspection du travail, peu importe qu’il y ait eu vice du consentement du salarié protégé en raison d’un harcèlement moral, le juge administratif est seul compétent en la matière. C’est de la validité de la rupture conventionnelle dont il est question, et celle-ci ne peut donc relever de la compétence du juge judiciaire. A défaut, il en résulterait une violation du principe de séparation des pouvoirs entre les deux ordres de juridiction. D’autant que c’est l’inspection du travail qui vérifie le consentement des parties, c’est donc le juge administratif qui est compétent pour remettre en cause cette décision.
- Confirmation de la jurisprudence antérieure, aucune exception possible
En 2014, la Cour de cassation (2) avait déjà rappelé que la validité de la rupture conventionnelle qui a été autorisée par l’inspection du travail relevait du juge administratif et non judiciaire, peu importe qu’il s’agisse d’une question de consentement du salarié. Ce qu’elle précise ici, c’est que peu importe que le vice du consentement résulte du harcèlement subi par le salarié. La Haute Cour ne souhaite pas faire d’exception au principe posée en 2014.
- Même logique qu’en matière de licenciement
Comme en matière de licenciement, dès lors qu’il est question de la validité d’un licenciement d’un salarié protégé (dont l’autorisation préalable de l’inspection est obligatoire), le juge judiciaire n’est pas compétent. Seul le juge administratif est à même de remettre en cause une décision administrative.
Toutefois, la Cour de cassation a admis une exception en cas de licenciement pour inaptitude autorisé par l’inspection du travail. Le salarié protégé peut agir devant le juge judiciaire pour faire constater que l’inaptitude trouve sa cause dans un harcèlement moral et obtenir ainsi la nullité de la rupture (3). Cela s’explique par le fait que l’inspection du travail ne contrôle pas la cause de l’inaptitude. Ce raisonnement ne serait pas transposable à notre affaire, puisque l’inspection du travail contrôle le consentement des parties.
(1) Application de la circulaire n°07/2012 du 30.07.12 (fiche 14).
(2) Cass.soc.26.03.14, n°12-21.136.
(3) Cass.soc.15.04.15, n°13-21.306.