Alors que fait rage le débat public sur l’élaboration du budget 2026 – et notamment de celui de la Sécurité sociale – Tripalio propose à ses lecteurs de prendre du recul sur ce thème avec une série pré-estivale sur l’évolution, sur le long terme, des modalités et du niveau du financement des principaux régimes collectifs et obligatoires de protection sociale français.

Après un premier épisode consacré à la présentation des conditions dans lesquelles le financement des assurances sociales a été adossé au salaire des travailleurs, nous montrons aujourd’hui que la création de la Sécurité sociale en 1945 a impliqué une expansion maîtrisée du financement de la protection sociale.
A la Libération, des régimes de protection sociale exsangues
Lorsque la France sort enfin de la Seconde Guerre mondiale, l’état des comptes des différents régimes de protection sociale qui couvrent les travailleurs, et notamment des assurances sociales instituées entre 1928 et 1930, ne figure pas parmi les principaux débats publics du moment. L’attention commune est en effet retenue ailleurs, par des problèmes bien plus cruciaux : retour des prisonniers, intégration des réseaux de résistance et répression des réseaux de collaboration, reconstruction du pays et de l’économie, gestion des rationnements dans de nombreux domaines, déclenchement de la crise en Indochine, par exemple. Il n’en demeure pas moins qu’afin de proposer des perspectives positives à une population française éreintée par la guerre et l’occupation allemande, le gouvernement provisoire de la République française (GPRF) du Général de Gaulle, mis en place à la Libération en juin 1944, a annoncé la mise en œuvre prochaine d’un nouveau plan complet de protection sociale.
Dans cet objectif, le gouvernement peut, certes, s’inspirer des régimes sociaux hérités des décennies précédentes. En revanche, il ne peut pas espérer les mettre à contribution afin d’amorcer les comptes de ceux qu’il entend créer. En effet, ces régimes sont à l’image de l’économie nationale et du budget de la nation : exsangues. On rappellera ainsi que c’est afin de financer, dans un contexte économique très difficile, de – fort maigres – allocations aux vieux travailleurs salariés, ou AVTS, que le régime de Vichy avait été amené, en 1941, à remplacer la capitalisation retenue en 1910 puis 1928 par la répartition. L’équation protection sociale du gouvernement du Général de Gaulle – qui, rappelons-le, intègre une forte composante communiste – est, en somme, complexe : il doit structurer un système n’ayant pas à pâlir, s’agissant de ses ambitions, de la comparaison avec les régimes précédents mais dont le niveau financement est compatible avec une économie en fort piteux état, à reconstruire tout à fait.
La Sécurité sociale, régime unifié de financement de la protection sociale
C’est dans une telle configuration que le gouvernement élabore le plan de Sécurité sociale, finalement institué par les ordonnances d’octobre 1945. Définies par l’ordonnance du 4 octobre 1945, les modalités du financement de la Sécurité sociale s’inscrivent dans une certaine continuité avec celles des assurances sociales de 1928 mais avec une volonté affichée de faire mieux. Alors que les secondes étaient financées par une cotisation de 10 %, sous plafond, la première est abondée à hauteur de 12 %, sous plafond là encore – avec financement à part égal par l’employeur et le salarié. « Le taux de la cotisation des assurances sociales est de 12 p. 100. La moitié de la cotisation est à la charge de l’employeur, l’autre moitié à la charge du salarié ou assimilé » dispose l’article 32 de l’ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la Sécurité sociale. Le plafond de cotisation est de 120 000 francs par an mais, à la différence du système précédent, il s’applique aux rémunérations et, par conséquent, tous les salariés sont affiliés au régime général pour leur rémunération inférieure à ce seuil.
En outre, à cette cotisation de 12 % s’ajoutent plusieurs cotisations abondant d’autres régimes de protection sociale. D’une part, une cotisation sous plafond d’un taux non négligeable de 4 % est destinée à assurer le financement de l’AVTS. D’autre part, le gouvernement ayant obtenu l’intégration des allocations familiales et des accidents du travail dans le périmètre de la Sécurité sociale – malgré les vives oppositions, respectivement, du syndicalisme chrétien et d’une partie des milieux patronaux et assurantiels – le financement de ces deux risques, à la charge de l’employeur, vient se cumuler à ceux précédemment évoqués. Dans le cas des allocations familiales, le taux de la cotisation est défini par arrêté ministériel : celui du 10 septembre 1946 le fixe ainsi à « 12,5 % du salaire départemental de base ». Dans le cas des accidents du travail, la détermination du taux de cotisation est moins homogène, dépendant du profil de risque et de prévention des entreprises. Encore faut-il toutefois préciser que les cotisations afférentes à ces deux risques ne sont pas véritablement nouvelles, dans la mesure où ils donnaient déjà lieu, auparavant, à cotisations à diverses caisses.
Ainsi la création de la Sécurité sociale unifie-t-elle, en rehaussant son niveau, le financement de la protection sociale des salariés français.



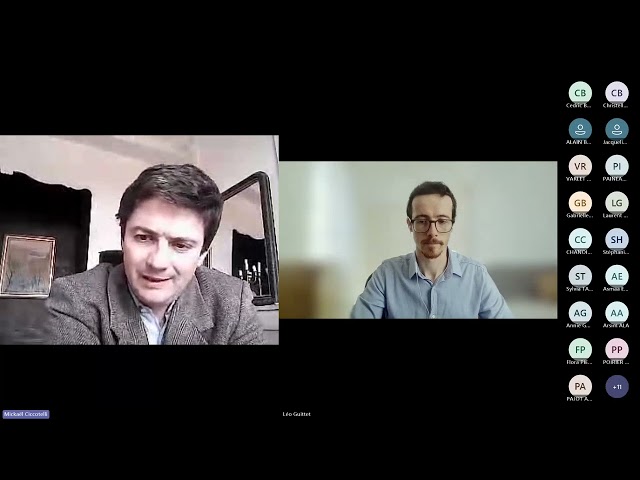


1 comment